II Croissance des performances
![]() 1°) Quelques rappels
1°) Quelques rappels
a)les fibres musculaires

![]()
 Dans
le I, nous avons analysé le muscle depuis le macroscopique jusqu'au moléculaire.
Nous avons ainsi décelé la présence de
fibres musculaires, qui composent les
faisceaux musculaires. Voici un petit rappel de la composition de ces fibres,
important pour la suite de la page, voir fig.1-1.
Dans
le I, nous avons analysé le muscle depuis le macroscopique jusqu'au moléculaire.
Nous avons ainsi décelé la présence de
fibres musculaires, qui composent les
faisceaux musculaires. Voici un petit rappel de la composition de ces fibres,
important pour la suite de la page, voir fig.1-1.
Une fibre musculaire mesure entre 3mm et 20cm, avec un diamètre variant de 10 à 100μm. Elle se compose d'un réseau capillaire plus ou moins développé, de mitochondries, de réserves en glucides et lipides, de phosphocréatine et enfin d'enzymes aérobies et anaérobies.
Mais dans le domaine du sport, il est très important de différencier plusieurs types de fibres car chez l'homme, les fibres musculaires ne sont pas touts identiques au sein d'un même muscle. Le muscle n'est donc pas un tissu homogène puisqu'il est constitué de fibres dont les propriétés mécaniques, enzymatiques et énergétiques sont différentes. On distingue en général deux ou trois principales types de fibres, voir tableau 1-2


Il serait en effet plus simple de considérer seulement deux types de fibres, les lentes et les rapides, mais les fibres intermédiaires auront plus tard leur rôle à jouer dans la croissance des performances. Pour simplifier au plus le contenu de cette page, nous utiliseront les termes de fibres I pour les fibres lentes, fibres IIa pour les intermédiaires et fibres IIb pour les rapides.
b) les unités motrices
 L'information
commandant à la fibre de se contracter provient d'un neurone un peu particulier
appelé
motoneurone (neurone moteur) . Les muscle
sont donc sous la dépendance des motoneurones eux même sous le contrôle du
système nerveux. Lorsqu'il atteint le muscle, l'axone du motoneurone se divise
en plusieurs branches axonales, chacune se dirigeant vers une fibre musculaire.
Dit autrement, un seul motoneurone stimule plusieurs fibres musculaires, voir
fig.1-3. L'ensemble constitué par un motoneurone et les fibres musculaires qu'il
innerve s'appelle une
unité motrice (UM). Le nombre
de fibres musculaires par UM dépend de la fonction du muscle : logiquement, plus
il doit être précis, plus faible sera ce nombre. Par exemple, il peut aller
d'une dizaine voir moins pour le muscle de l'oeil à 2000 pour les quadriceps.
Les muscles peuvent compter de 100 à 700 UM.
L'information
commandant à la fibre de se contracter provient d'un neurone un peu particulier
appelé
motoneurone (neurone moteur) . Les muscle
sont donc sous la dépendance des motoneurones eux même sous le contrôle du
système nerveux. Lorsqu'il atteint le muscle, l'axone du motoneurone se divise
en plusieurs branches axonales, chacune se dirigeant vers une fibre musculaire.
Dit autrement, un seul motoneurone stimule plusieurs fibres musculaires, voir
fig.1-3. L'ensemble constitué par un motoneurone et les fibres musculaires qu'il
innerve s'appelle une
unité motrice (UM). Le nombre
de fibres musculaires par UM dépend de la fonction du muscle : logiquement, plus
il doit être précis, plus faible sera ce nombre. Par exemple, il peut aller
d'une dizaine voir moins pour le muscle de l'oeil à 2000 pour les quadriceps.
Les muscles peuvent compter de 100 à 700 UM.




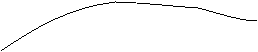

♦ Schéma animé d'une unité motrice SANS entraînement
♦ Schéma animé d'une unité motrice AVEC entraînement

2°) Le rôle des différents types de fibres
Tout d'abord, comment différencier ces fibres? Pour étudier la composition d'un muscle, il est nécessaire d'en recueillir un fragment par biopsie puis de l'analyser. Une des principales différences entre les fibres réside dans leur vitesse de raccourcissement. Or, cette vitesse dépend principalement de l'activité de la myosine ATPase. On sait également grâce à des études récentes que les molécules d'actines possèdent une structure identique pour tous les types de fibres. Les différences portent surtout sur les autres filaments, notamment ceux de myosine. Les corps des molécule de myosine sont composés de deux chaînes lourdes (MHC) enroulées de façon hélicoïdale. On en distingue trois principaux types: MHCI, MHCIIa, MHCIIb, en rapport bien sûr avec les fibres I, IIa, IIb.
Mais une fibre musculaire ne se limite pas à la myosine seulement et les différences entres les fibres I, IIA et IIB sont nombreuses, voir tableau 2-4.
| Caractéristiques | fibre I | fibre IIA | fibre IIB |
| Vitesse de raccourcissement | lente | élevée | élevée |
| Résistance à la fatigue | élevée | moyenne | faible |
| Réseau capillaire | développé | moyen | faible |
| densité mitochondriale | élevée | moyenne | faible |
| réserves en glucides | importante | importante | importante |
| réserves en lipide | importante | moyenne | faible |
| Diamètres des fibres | faible | moyen | élevé |
| Nombre d'unité par unité motrice | faible | moyen | élevé |
| Myosine ATPase | faible | élevée | élevée |
| Phosphocréatine | faible | élevée | élevée |
| Enzymes aérobie | élevée | moyenne | faible |
| Enzymes anaérobie | faible | élevée | élevée |

Quelques commentaires sur ces différences
- Le réticulum sarcoplasmique des fibres I (lentes) est assez peu développé malgré un pourcentage de la fibre occupé par des myofibrilles légèrement plus faible. Les fibres lentes possèdent en revanche davantage de mitochondries. On peut donc dire que ce type de fibres a les atouts d'une contraction peu intense mais longue.
- La plus grande résistance à la fatigue des fibres lentes s'explique par de grandes capacité à produire de l'énergie en utilisant l'oxygène. Cette capacité s'explique par le réseau capillaire développé qui apporte du O2 (dioxygène)à proximité de la fibre, la concentration en myoglobine pour le transporter à l'intérieur, de la fibre, le nombre de mitochondries pour l'utiliser, le faible diamètre (qui implique une distance courte à parcourir par l'O2 pour aller jusqu'aux mitochondries.)
-Les termes relatives à la couleur (fibres rouges ou blanches,voir le tableau 1-2) s'expliquent ici : la myoglobine étant une protéine de couleur rouge, sa concentration dans les différentes fibres donne des couleurs plus ou moins blanches (fibres II) ou rouges (fibres I).
En résumé sur les fibres
Les fibres I, (lentes, rouges) sont très résistantes à la fatigue, peuvent utiliser l'oxygène comme énergie et ont un petit diamètre. Par contre, leur vitesse de raccourcissement est assez faible et elles ne sont pas très puissantes.
Les fibres II, (rapides,blanches) sont peu résistantes à la fatigue, n'utilise pas l'oxygène et ont un diamètre important. Par contre, leur vitesse de raccourcissement est très élevée et elles sont très puissantes.
On en déduit donc assez facilement que les fibres I, lentes seront sollicitées pour les efforts longs et endurants, tandis que les fibres II, rapides, seront sollicitées pour les efforts brefs, toniques et puissants.


 Pour illustrer la déduction ci-dessus, une expérience simple peut être
réalisée : si l'on découpe avec précaution une truite, on peut apercevoir une
fine bande rouge sur les flancs, le reste étant de la chair blanche. Ces
différences correspondent aux proportions de fibres lentes (faibles, environ
10%) et rapides (élevée, 90%). Des études scientifiques menées par des abonnés
de "Chasse et pêche" ont montré que les 10% de fibres rouges étaient utilisées
pendant 95% du temps, notamment quand le poisson flânait dans les
courants. Les fibres rapides ne sont recrutées que pour des actions très
ponctuelles comme saisir les proies.
Le pêcheur pourra alors percevoir la puissance de ces fibres et leur
fatigabilité : si le fil ne casse pas, il n'est pas nécessaire de se battre 2
heures avec le poisson avant de pouvoir le ramasser dans l'épuisette; il se
fatigue assez vite.
Pour illustrer la déduction ci-dessus, une expérience simple peut être
réalisée : si l'on découpe avec précaution une truite, on peut apercevoir une
fine bande rouge sur les flancs, le reste étant de la chair blanche. Ces
différences correspondent aux proportions de fibres lentes (faibles, environ
10%) et rapides (élevée, 90%). Des études scientifiques menées par des abonnés
de "Chasse et pêche" ont montré que les 10% de fibres rouges étaient utilisées
pendant 95% du temps, notamment quand le poisson flânait dans les
courants. Les fibres rapides ne sont recrutées que pour des actions très
ponctuelles comme saisir les proies.
Le pêcheur pourra alors percevoir la puissance de ces fibres et leur
fatigabilité : si le fil ne casse pas, il n'est pas nécessaire de se battre 2
heures avec le poisson avant de pouvoir le ramasser dans l'épuisette; il se
fatigue assez vite.
3°) L'entraînement et les fibres : duo gagnant de la performance.
Important :A partir de maintenant, commence la partie répondant à notre problématique. Si vous avez un doute ou un point un peu flou, n'hésitez pas à retourner au menu principal afin de revenir sur une partie du TPE que vous souhaitez reprendre.
Pour faciliter la compréhension de cette partie, nous limiterons l'étude à un seul sport : l'athlétisme; mais il est clair que toutes les explications et déductions seront applicables à tous les autres sports.
a) Les différents types d'entraînements et leurs effets.
Lorsqu'il est question de croissance des performances dans le domaine du sport, on pense immédiatement à l'entraînement. L'entraînement vise à améliorer la puissance du muscle et son endurance, sa capacité à effectuer des exercices de longue durée. En d'autres termes, l'entraînement consiste à reculer les limites de la fatigue. Il existe deux grands types d'entraînement, l'entraînement en puissance ou en endurance.
L'entraînement en endurance(ou en aérobie): il exige la réalisation d'efforts prolongés, d'intensité moyenne, plusieurs fois par semaine. Il favorise la voie aérobie, c'est-à-dire l'utilisation des graisses. On observe dans le muscle une augmentation de la vascularisation, du nombre de mitochondries, et une modification des protéines contractiles, qui évoluent des formes rapides vers les formes lentes. Ces modifications s'établissent rapidement, au bout de quelques semaines d'entraînement, mais peuvent disparaître aussi vite s'il est interrompu. Ce type d'entraînement vise bien évidemment à améliorer les caractéristiques des fibres I, lentes.
L'entraînement en force: il vise, lui, à améliorer la force et la vitesse, et repose sur des bases différentes. Il ne s'agit pas, dans ce cas, d'effectuer des efforts longs et répétés, mais, au contraire, des exercices courts, rapides et intenses, comme la musculation ou le sprint. Ces exercices doivent également être pratiqués plusieurs fois par semaine, et ils entraînent une augmentation de la force musculaire, ainsi qu'une hypertrophie des muscles. On sait que cette hypertrophie est due à la multiplication des myofibrilles et à un accroissement du diamètre des fibres rapides. Mais l'on s'explique mal encore comment l'exercice conduit à ce phénomène physiologique et anatomique. Au niveau biologique, l'on observe une augmentation du taux de certaines hormones comme l'hormone de croissance ou la testostérone, qui sont nécessaires à la synthèse des protéines, donc à l'accroissement de volume des muscles. On observe également, dans les muscles constitués surtout de fibres rapides, une diminution de la vascularisation et des mitochondries, ce qui témoigne donc en faveur d'un développement de la voie énergétique anaérobie. Comme vous l'aurez compris, ce type d'entraînement a pour but de développer les facultés des fibre II, rapides.
Les différentes fibres musculaires ne réagissent pas de la même façon lors de leur recrutement chronique, c'est à dire lors de l'entraînement. Le cas le plus concret est la très nette différence de physiologie entre les athlètes pratiquant le 100 ou 200 mètres et ceux parcourant des distances supérieures à 1500 mètres, voir, image.3-5.


Comme on peut le constater, le coureur de longues distance, développant ces fibres I, lentes, présente une musculature bien moindre que le sprinter. On pourrait donc croire que le sportif le plus musclé est de par le fait bien meilleur que le sportif présentant une physiologie des plus banales. Et pourtant, essayez de faire courir le sprinter pendant plus de 30 secondes et vous verrez qu'il est incapable de maintenir une allure élevée au delà. Il y a donc deux métabolismes différents, chacun ayant des caractéristiques de développement précises.
Le sprinter.
Il base l'essentiel de son entraînement sur la force, c'est a dire des exercices courts mais intenses et rapides. Il s'agit par exemple pour un sprinter d'effectuer 20 fois 50 mètres à une allure très vive avec un temps de récupération très faible entre chaque. Ce genre d'exercice a pour effet de recruter les fibres II,rapides, mais également d'augmenter la section transversale du muscle: c'est ce que l'on nomme l' hypertrophie(voir plus haut). Mais attention, on ne peut pas prévoir quelle hypertrophie on est en droit d'attendre, car trop de facteurs sont impliqués, tels que le niveau de départ de l'individu, sa nutrition, son "plafond génétique". L'augmentation de la section du muscle est due à la fois à la hausse du nombres de myofibrilles et à l'accroissement de la surface de chacune d'entres elles par ajout de filaments d'actine et de myosine à la périphérie des myofibrilles. La densité des myofilaments (espacement entre filament de myosine) ne semble pas modifiée par l'entraînement sauf peut être à long terme, ce qui entraînerait une hausse de la force par unité de section transversale.
Mais dans le cadre d'un entraînement pour sprinter, il n'y a pas que le muscle qui y soit sensible. On remarque que le système nerveux est sensible à l'entraînement lui aussi; au début d'un entraînement en puissance, il est possible de constater des gains de force sans modification de la taille du muscle. Et même lorsque la surface de section du muscle augmente, avec l'entraînement, ce n'est souvent pas dans les même proportions que les performances. Tout ceci est donc en grande partie attribuable à une modification de la commande nerveuse, c'est à dire à une plus grande sommation (un plus grand recrutement) spatiale et temporelle des influx nerveux moteurs. En un mot, le but de l'entraînement en force est de permettre au système nerveux de recruter un plus grand nombre de fibres et toutes en même temps, voir fig.3-6.



![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()








![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Le recrutement des unités motrices intervient en début de
travail de musculation
expliquant ainsi les progrès rapides. Le schéma de Fukunaga (1976) traduit les
rapports
entre phénomènes nerveux et hypertrophie.
- (I) Situation de départ: le débutant ne recrute que peu de fibres (points
noirs)
- (II) Au bout de quelques semaines, le nombre d'unités motrices recrutées
augmente, sans hypertrophie.
-(III) Dans la suite de l'entraînement c'est surtout l'hypertrophie qui est la
cause
principale du gain de force.

Le coureur de fond.
Comme le montre les images 3-5, le coureur de 10000 mètres présente une musculature peu (voir pas) développée. On observe donc aucun phénomène d'hypertrophie chez ce genre d'athlète. Les performances qu'ils réalisent sont pourtant autant, voir plus impressionnantes que celles des sprinters (les meilleurs peuvent maintenir une allure de 25km/h pendant plus de 30km). Il y a donc un autre phénomène qui permet aux athlètes de courir plus vite et pendant plus longtemps. Pour comprendre ce phénomène, il faut revenir au tableau présentant les différences entre les différentes fibres. Dans le cas du coureur de fond, ce sont bien sur les fibres I qui sont concernées. On retiendra pour la suite qu'elles ont un diamètre assez faible, une densité mitochondriale élevée (et donc par conséquent un taux d'enzymes aérobies élevé aussi), et un réseau capillaire développé.
Dans un premier temps, on peut noter que l'entraînement en endurance augmente le nombre de capillaires par fibre, c'est ce qu'on appelle l'anigogénèse. Ce type d'entraînement améliore aussi la densité des capillaires par fibre, c'est à dire leur nombre au mm2. Un bon réseau capillaire est donc important pour mieux transporter l'oxygène dans les fibres I qui en ont besoin, et cet apport permet de limiter la participation du métabolisme anaérobie et donc la fatigue qui en résulte.
On peut suivre à peu près le même raisonnement pour les mitochondries : l'entraînement en endurance augmente le nombre et la taille des mitochondries dans les fibres; Le pourcentage du volume musculaire occupé par les mitochondries est d'environ 5% chez un individu normal et ce pourcentage peut doubler si l'on est entraîné en endurance.
b) Champion : la sélection naturelle
"On ne naît pas champion, on le devient."
Cette citation célèbre revient souvent de nos jours, notamment lorsque l'on veut souligner le fait qu'un sportif ne doit sa performance qu'à ses efforts et ses sacrifices. Cette phrases est vraie dans un sens, puisqu'il n'est pas question de remettre en question tous les efforts endurés par un sportif pour arriver à son but final. Mais est il possible à n'importe quel être humain de courir un 100 mètres en moins de 10 secondes ou de lancer un poids à plus de 30 mètres dès l'instant qu'il reçoit l'entraînement nécessaire dès son plus jeune âge? Un sprinter de haut niveau peut il du jour au lendemain décider de remporter un marathon? Autant de questions pour lesquelles il n'existe qu'une réponse : la myotypologie, qui est la composition du muscle selon ses différents types de fibres
Le tissu musculaire n'est pas homogène. Tout au long de cette page, nous avons différencié 3 principaux types de fibres musculaires. La composition en fibres rapides ou lentes d'un muscle dépend principalement de sa fonction. Chez les athlètes de haut niveau, les pourcentages respectifs en fibres I ou II sont, pour un groupe musculaire donné, fortement dépendants du sport pratiqué, voir fig.3-7.
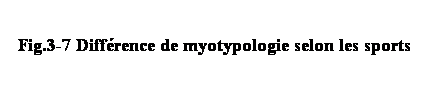
![]()

![]()
![]()
 Ce résultat est il le fruit de l'hérédité
ou lié aux années d'entraînement? En d'autres termes, persévère-t-on dans un
sport parce que l'on possède au départ les bonnes fibres ou au contraire,
l'entraînement dans une discipline modifie-t-il la myotypologie?
On a longtemps cru que le changement de typologie était impossible, mai en
réalité la conversion des fibres est possible. La transformation des fibres :
Ce résultat est il le fruit de l'hérédité
ou lié aux années d'entraînement? En d'autres termes, persévère-t-on dans un
sport parce que l'on possède au départ les bonnes fibres ou au contraire,
l'entraînement dans une discipline modifie-t-il la myotypologie?
On a longtemps cru que le changement de typologie était impossible, mai en
réalité la conversion des fibres est possible. La transformation des fibres :
- L’ordre de la transformation :
Les fibres sont susceptibles de se transformer à la suite de certaines
sollicitations. Sur la
fig3-8, on constate l’ordre de la transformation et l’existence de fibres mixtes
ou hybrides
comportant deux types de myosine. Si la transformation des fibres suit un ordre
bien précis
on a découvert que pour les fibres I et IIb on pouvait sauter directement d’un
type à l’autre
sans suivre l’ordre linéaire : ces fibres ont été appelées « jump fibers »
(fibres « saut »)

Malgré tout, les modifications typologiques sont assez mineures. Les larges différences entre les athlètes de fond ou pratiquant des disciplines explosives sont donc aussi dues en grande partie au fait que ceux qui "percent" sont "génétiquement programmés" pour cette activité. Il est donc illusoire de vouloir devenir champion olympique de ski de fond sans un capital génétique ad hoc.